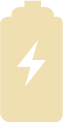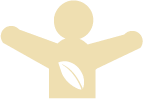Les astuces pour une vie saine, verte et pas chère
Dans mon article sur la lessive maison, j’évoquais la lessive au lierre. Je l’ai maintenant testée et ça fonctionne très…
Faire de la confiture maison, c’est tout simple ! Il vous suffit d’avoir des fruits et du sucre. Voici la recette…
Dans L’âge des Low Tech, Philippe Bihouix traite la question délicate de la technologie à l’ère de la raréfaction des…
Les dernières idées et réflexions
J’aurais pu appeler cet article « comment le minimalisme va changer votre vie » ou encore « 10 bonnes raisons de devenir minimaliste »…
Depuis quelque temps, j’ai totalement cessé de regarder des vidéos en ligne (et des vidéos tout court, en fait). Retour…
Vous pensez que vous ne pourriez pas vivre sans argent ? L’Irlandais Mark Boyle a contesté cette idée reçue et voici…
Avec Comment tout peut s’effondrer, Pablo Servigne et Raphaël Stevens signent un ouvrage fondateur pour la collapsologie française. Ce livre…